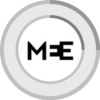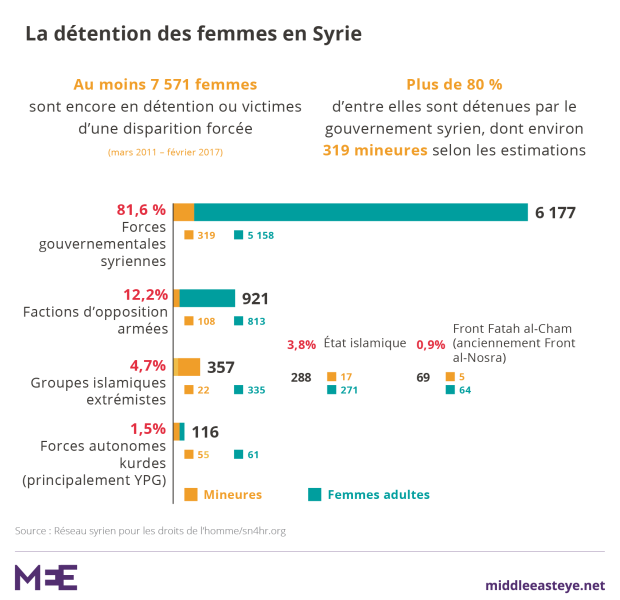Élever un bébé dans une prison syrienne

Oum Omar ne se souvient pas de la date exacte : tout ce qu’elle sait, c’est qu’ils étaient dans la prison d’Adra, à l’extérieur de Damas. « Je n’ai pas vu si c’était le jour ou la nuit, affirme-t-elle. Nous n’avions pas le droit de sortir pour aller à la salle de bains ou prendre une douche. »
Il n’y avait pas beaucoup de place pour se dégourdir les jambes dans la pièce sombre et sans air que son fils et elle partageaient avec leurs codétenues.
« Je me levais et je créais un espace afin de pouvoir lui apprendre à marcher, jouer avec lui », raconte Oum Omar dans sa nouvelle habitation, située dans la campagne d’Idleb. Elle ne souhaite pas révéler sa véritable identité, craignant pour sa vie, et demande à être appelée « Oum Omar » – qui se traduit en français par « mère d’Omar ».
« J’étais d’un côté et une autre fille, Marwa, était devant moi, à environ un mètre cinquante de distance. Je marchais avec lui en sa direction, en me servant de mes mains. Puis nous échangions les rôles. »
Lorsqu’Omar tombait, sa mère l’attrapait. Lentement mais sûrement, après des premiers pas hésitants, il a trouvé la confiance pour marcher.
« Il était fort, affirme-t-elle. C’était le seul bébé là-bas. Le regarder rendait les autres prisonnières heureuses. C’était un moment de bonheur unique, entre l’obscurité de cette prison et la cruauté de ses gardes. »
Omar a passé les premières années de sa vie dans une prison syrienne, où sa mère a été torturée. Voici leur histoire.
« Ce n’était pas la vie à laquelle je m’attendais »
Quand elle était plus jeune, Oum Omar, aujourd’hui âgée de 38 ans et originaire de Deir ez-Zor, dans l’est de la Syrie, imaginait ce que la vie pouvait lui réserver.
« Comme toute femme, je rêvais d’avoir des bébés, d’élever ma famille dans une maison décente, comme toute famille dans le monde », se souvient-elle.
« Quand j’étais adolescente, j’étais obsédée par les bébés, je prenais soin de ceux de mes voisins et de nos amis quand ils rendaient visite à ma mère. Je rêvais d’en avoir au moins un, et j’en ai eu un. Mais malheureusement, ce n’était pas la vie à laquelle je m’attendais. »
Oum Omar et son mari Khalid, également originaire de Deir ez-Zor, se sont mariés en 2006 et ont déménagé à Alep avant la guerre, où il était employé dans une entreprise de fabrication de tissus par son oncle.
Lorsque le conflit a éclaté, la ville, la deuxième plus grande du pays, est rapidement devenue un foyer de protestations contre le gouvernement du président Bachar al-Assad.
Khalid vivait dans les quartiers rebelles de l’est : il a rejoint l’Armée syrienne libre mais a été tué par un tir de mortier lors d’une bataille contre les forces gouvernementales en août 2013. Il avait 44 ans et était marié à Oum Omar depuis sept ans.
Omar est né en mars 2014 à Eza’a, dans l’ouest d’Alep. Le père et le fils ne se sont jamais vus.
Oum Omar était veuve, seule et sans contact avec sa famille, qui désapprouvait l’activisme du couple contre le gouvernement. Elle avait déjà été emprisonnée en 2011 et en 2013 pour son opposition à Assad, la deuxième fois, pendant trois jours.
« Je n’ai pas pris la peine d’essayer de leur parler ou de les convaincre, explique-t-elle. J’ai poursuivi mon activisme. »
Sa vie, affirme Oum Omar, ressemblait alors à celle d’une veuve célibataire. Elle pleurait la perte de son mari, et s’inquiétait également pour son propre avenir et celui de son fils.
Avant même la mort de Khalid, Oum Omar craignait de se faire arrêter par le gouvernement. Depuis près de deux ans, elle acheminait des médicaments indispensables vers l’est d’Alep via Bustan al-Qasr, un quartier rebelle qui abritait des groupes d’opposition.
Le quartier, qui était un repaire fréquent de snipers, servait de couloir entre les parties de la ville divisée avant de devenir une zone interdite après des affrontements en 2014.
Oum Omar savait que son activisme était extrêmement risqué, mais elle le considérait comme son devoir. « Oui, j’étais téméraire. Mais je devais le faire et je ne le regrette pas. J’avais une priorité : les personnes malades qui avaient besoin de médicaments. »
Elle pensait que les espoirs qu’elle nourrissait dans sa jeunesse ne deviendraient jamais une réalité. « C’était ma vie après l’accouchement et la mort de Khalid, explique-t-elle. J’avais du mal à allaiter mon bébé à cause de l’intensité et de la pression que je subissais à l’époque. »
Puis, en septembre 2014, la vie d’Oum Omar a pris une nouvelle tournure, dramatique.
Une nuit, cinq hommes d’une agence de renseignement du gouvernement ont fait irruption chez elle alors qu’Omar et elle dormaient. Elle pense qu’ils ont été trahis par un voisin.
Les hommes ont cassé la vaisselle et les chaises et renversé les affaires de la famille. Ils ont fouillé la maison, insulté Oum Omar et emporté des paquets de médicaments. Ils l’ont ensuite accusée d’avoir aidé des terroristes blessés en leur fournissant des médicaments.
Oum Omar a rejeté les allégations et refusé de fournir les noms de ses amis et connaissances, de peur que ces personnes ne soient également soupçonnées et arrêtées. Quand elle s’est mise à crier, les hommes ont pointé des armes contre sa tête. « Le raid a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase », se souvient-elle.
Elle et Omar ont ensuite été emmenés au siège de l’agence, à Damas, à plus de 300 kilomètres de là, où « l’horreur a commencé », décrit-elle.
Oum Omar avait les yeux bandés quand elle est entrée dans le système pénitentiaire d’État – mais elle pouvait déjà détecter « l’odeur nauséabonde et sale » qui allait imprégner sa vie au cours des années à venir.
« J’étais choquée, raconte-t-elle. Je tremblais, avec mon bébé en pleurs, me demandant quel allait être mon destin. »
Il n’y avait pas de ventilation. Pour y remédier et tenter de faire entrer de l’air, les prisonnières avaient creusé des trous dans les murs
La mère et le fils allaient y passer près d’un mois avant d’être transférés dans d’autres prisons à travers la capitale, dont celle d’al-Fiha’a. « Ils m’ont pris le bébé la première nuit, pour me mettre sous pression, puis ils me l’ont rendu après le premier interrogatoire. »
Omar avait deux mois à l’époque.
« Quand je suis entrée, il y avait par terre une eau d’une odeur épouvantable, indique-t-elle. Les murs étaient recouverts de mots, les noms des anciens prisonniers qui avaient été incarcérés dans la même pièce. C’était comme un sous-sol abandonné qui n’avait pas été réparé depuis des lustres. J’arrivais à peine à marcher parce que j’avais la tête qui tournait. Je n’avais pas dormi et c’était la nuit. »
La pièce était remplie d’autres femmes. Il n’y avait pas de ventilation. Pour y remédier et tenter de faire entrer de l’air, les prisonnières avaient creusé des trous dans les murs. Tout au long de sa première nuit, Oum Omar entendait des cris d’hommes et de femmes.
« Dis-moi tout ou tu ne verras plus jamais ton bébé »
Pour son premier interrogatoire, Oum Omar a été conduite dans une pièce. Ses mains étaient liées, ses yeux bandés. Elle recevait des coups à chacun de ses pas.
L’interrogateur lui a posé des questions sur sa famille, son mari, son travail. Elle a été accusée d’avoir apporté des fournitures médicales pour aider l’Armée syrienne libre.
Quand Oum Omar a commencé à répondre, son interrogateur l’a frappée à la tête. « Arrête de mentir et dis-moi la vérité sur ton travail et ton mari ! », criait-il, d’après ses souvenirs.
« Au début, j’étais complètement terrifiée à cause de la torture et des coups, confie Oum Omar. J’avais peur de me faire violer ou tuer. »
Puis il y a eu les menaces visant Omar. Des groupes de défense des droits de l’homme ont fait état de la manière dont le gouvernement Assad a torturé et tué des enfants pour punir leur famille ou extraire des informations.
« Mon enfant n’avait rien à voir avec les prisons ou quoi que ce soit d’autre, explique Oum Omar. Mais le régime syrien est assez criminel pour tuer et emprisonner des enfants ou des bébés. J’avais toujours mon fils en tête. Qui allait s’occuper de lui ? Étaient-ils prêts à le tuer aussi ? Ou à le battre devant moi ? »
Au lendemain de son premier interrogatoire, Oum Omar a été abandonnée dans une pièce surpeuplée. Omar pleurait sans cesse. Les gardes ne prêtaient pas attention à ses appels pour obtenir de la nourriture ou des fournitures pour bébé. Elle a fini par devoir improviser des couches en déchirant des morceaux de vieux vêtements.
Les séances de torture sont vite devenues un élément régulier de sa vie en prison. « À mon retour de chaque interrogatoire, je tenais mon fils et je pleurais, raconte Oum Omar. Lui aussi se mettait à pleurer. »
Les prisonniers appellent cette méthode « shabeh », un procédé qui, selon un rapport, cause « des douleurs horribles, des ruptures de ligaments et une paralysie semi-permanente des mains »
Oum Omar a également dû faire face à des séances de torture nocturnes, dont la première est survenue après une semaine de détention. Elle se souvient d’avoir confié Omar à une amie qu’elle avait rencontrée en prison avant d’être traînée dans une grande pièce, où l’attendait un « homme gros et d’âge mûr avec un gros bâton dans la main », raconte-t-elle. « Il a commencé à se rapprocher de moi et m’a dit : "Dis-moi tout ou tu ne retourneras plus jamais voir ton bébé ce soir." Je n’ai rien dit. J’étais sous le choc. »
L’homme a hurlé contre Oum Omar pour la faire avouer, puis l’a battue jusqu’à la faire tomber par terre. Elle était couverte de sang et incapable de se tenir debout. Plus tard, il est revenu avec un complice et une corde qu’il a accrochée au plafond. Oum Omar y a ensuite été suspendue par les mains, liées, ses pieds ne touchant qu’à peine le sol.
À LIRE : Un Syrien raconte ses quatorze mois au purgatoire
Ce qu’elle décrit est une forme de torture commune et avérée qui est pratiquée par le régime d’Assad. Les prisonniers appellent cette méthode « shabeh », un procédé de pendaison qui, selon un rapport publié par le Centre de documentation des violations en Syrie en septembre 2013, cause « des douleurs horribles, des ruptures de ligaments et une paralysie semi-permanente des mains ».
Oum Omar est restée attachée pendant des heures. D’autres questions ont suivi. Elle ne disait pourtant toujours rien. « Je savais que si je disais quelque chose, ils allaient continuer à me torturer et augmenter l’intensité et la brutalité de la torture. »
Ce traitement s’est poursuivi pendant près de deux mois. Elle se rappelle de nombreuses autres détenues violées et torturées à plusieurs reprises, mortes pendant leur pendaison ou suite à un manque de traitement médical.
Un jour, Oum Omar a été déplacée vers la tristement célèbre section 215 où, selon le Centre de documentation des violations en Syrie, jusqu’à 70 prisonniers sont entassés dans une cellule de quatre mètres sur quatre. Des témoignages cohérents de survivants décrivent des prisonniers privés de nourriture ou jetés au sol, « nageant dans une piscine de sang et de pus qui s’écoule de leur corps en raison de l’absence de désinfectants et des conditions d’hygiène déplorables ».
En décembre 2015, Human Rights Watch a rapporté qu’au moins 3 532 détenus avaient perdu la vie dans le centre, sur la base de preuves sorties clandestinement de Syrie, bien que le groupe considère ce chiffre comme une sous-estimation.
Pour beaucoup de Syriens, le centre est tout simplement connu sous le nom de « section de la mort ».
Expliquer le monde à quelqu’un qui ne l’a jamais vu
En décembre 2014, Oum Omar et Omar ont été emmenés à la prison d’Adra, où allaient devoir se passer le reste de leur détention.
Environ un an après leur arrestation, Oum Omar a commencé à parler à Omar du monde extérieur, « de la vie réelle, des parcs, de l’école et ainsi de suite ».
Omar a commencé à former des mots à près de 18 mois et sa mère lui enseignait des parties du Coran. « Son premier mot a été "Maman", un mot qu’il a prononcé très approximativement », se remémore-t-elle. Apprendre à son fils le mot « Papa » a suscité une grande tristesse – mais Oum Omar voulait qu’Omar se souvienne qu’il avait un père.
Les progrès du bébé avaient un effet positif sur les autres prisonnières. « L’atmosphère dans la cellule de prison était joyeuse malgré les conditions désespérées dans lesquelles nous vivions toutes, raconte Oum Omar. Tout le monde embrassait Omar. Mais quand les gardes entendaient que la cellule devenait bruyante et commençaient à frapper à la porte métallique, cela faisait pleurer Omar.
« Ils ne me fournissaient pas de lait ou d’autres produits dont j’avais besoin pour mon nouveau-né. Sa taille et son poids étaient bas en raison du manque de nourriture au moment où il était censé grandir. »
« Un jour, il a eu une infection à cause de la chaleur dans la prison. Il était si mal en point, il n’arrivait pas à dormir ni à se calmer. Les prisonnières sont venues et m’ont emmenée chez le médecin de la prison pour lui donner des médicaments. » Mais Omar n’allait pas mieux. Finalement, des amies « avaient des feuilles de tisane que nous avons mises dans l’eau et, au bout d’une demi-heure, il est tombé dans un sommeil profond. »
La prison était la maison d’Omar. Parfois, il jouait avec une couverture – mais c’était un monde où il était trop jeune pour se faire des amis.
« Cela m’a brisé le cœur, parce que je me suis souvenue de l’époque où j’étais enceinte de lui et de la vie future que j’avais rêvé de lui offrir, confie sa mère. Je rêvais de lui acheter son petit lit et ses jouets, tout ce dont toute mère rêve d’avoir pour son bébé. »
« Cela me fend le cœur. Cela m’a fait pleurer de nombreuses fois la nuit, alors que je pensais à un avenir heureux avec son père, qui est déjà mort. »
À LIRE : Syrie : une nation traumatisée
Oum Omar chantait pour bercer son fils et l’aider à dormir ou « commenç[ait] à lui raconter de courtes histoires sur le Prophète Mohammed et ses camarades pour tenter de le rassurer ».
Mais parfois, Omar n’arrivait pas à dormir parce qu’il faisait trop chaud ou trop froid – ou à cause des bruits de torture émanant de la cour de la prison.
« Je lui bouchais les oreilles pour empêcher ces voix d’entrer dans sa tête, explique Oum Omar. Je n’y arrivais pas. Il pleurait si fort quand il entendait ces voix. »
Pour tenir le coup, Oum Omar s’est accrochée à sa foi et aux luttes du prophète ainsi qu’à l’amour de son fils et aux encouragements de ses codétenues.
« De nombreuses fois, je me suis mise à pleurer à cause de la pression et du désespoir. Je pensais que j’allais mourir ici et que je ne sortirais plus jamais, que je n’aurais plus jamais une vie normale, dans une maison. C’étaient les pires jours de ma vie. »
« J’ai fait le serment que je n’allais pas abandonner, pour Omar, tant qu’il est avec moi... pour lui et son défunt père que j’aime tant et qui m’a laissé une partie de lui. Je prendrai soin de lui pour le reste de ma vie. »
La renaissance d’Omar
Puis un jour, Oum Omar et Omar ont été libérés. Le 8 février 2017, le gouvernement a conclu un accord avec les forces d’opposition qui a abouti à la libération de 50 femmes des prisons gouvernementales. Dans le cadre de cet accord, Oum Omar a dû payer à un juge un peu moins de 6 000 dollars.
Son soulagement était impossible à contenir, se souvient-elle, lorsqu’elle a annoncé à Omar qu’ils allaient rentrer chez eux et voir le soleil, des gens, des enfants. « J’ai beaucoup pleuré, dit-elle. C’était incroyable de voir la réaction sur son visage. Il était en pleurs et heureux. »
Oum Omar vit aujourd’hui avec une amie dans la campagne d’Idleb et est de nouveau en contact avec sa sœur, avec qui elle avait perdu contact lorsqu’elle était en prison. Elle a également l’occasion de réfléchir à ce que ses années de détention leur ont causé, à elle et à son fils, qui appréhende le monde extérieur pour la première fois.
« Un jour, il a demandé "Sommes-nous au paradis, Maman ?" parce qu’il avait vu des oiseaux et des chats et qu’il voulait savoir, raconte-t-elle. Vous pouvez imaginer sa surprise lorsqu’il a pris conscience que c’était le monde réel. »
Omar, qui arbore aujourd’hui de courts cheveux bruns, vit avec d’autres enfants dans un centre de réhabilitation, où l’on tente de le réintégrer dans la société. Sa mère lui rend visite autant qu’elle le peut.
Ahmad Khaldon, directeur adjoint de l’établissement, a déclaré que le cas d’Oum Omar n’était pas inhabituel dans un conflit qui a tué plus de 470 000 personnes, selon le Centre syrien pour la recherche politique.
« Ils ont traversé des circonstances similaires, ont été confrontés aux conséquences de la guerre, à ses effets physiologiques et à la perte de leur enfance, indique-t-il. « Nous essayons de leur apporter l’atmosphère appropriée pour élever une famille, ce dont il leur manque lorsqu’ils sont de retour à la maison. »
Au début, Omar avait des problèmes d’interaction avec les autres enfants ; il se battait notamment. Mais aujourd’hui, il est plus détendu, joue et mange correctement. « C’est comme s’il était né une seconde fois en voyant un monde entièrement nouveau et en s’adaptant aux aspects de sa nouvelle vie, affirme Oum Omar. Il a des flashbacks de la vie en prison, mais son état s’est amélioré récemment. »
Il forme de nouveaux souvenirs de choses qu’il n’avait jamais vues auparavant, des animaux, des bâtiments, des voitures, de la nourriture.
« J’espère qu’il se débarrassera de toutes les mauvaises influences qu’il a connues dans les trois premières années de sa vie et qu’il commencera une nouvelle page, sans bombardement, ni morts, ni combats, qu’il aura juste envie de vivre une vie normale et décente où il pourra avoir ce qu’il voudra. »
Oum Omar racontera-t-elle à Omar toute l’histoire de ces années passées en prison ?
« Je lui dirai ce qu’il s’est passé, répond sa mère. Je ne lui mentirai jamais. Il apprendra sur Internet ce qui est arrivé à son pays, à sa terre, à son père et comment la mort et la dévastation ont envahi son pays. »
« Les médias disent tout aux gens, donc je préfère le lui dire moi-même. Je lui dirai comment ils torturaient des hommes et des femmes. Et combien il était difficile de continuer, d’être positif et d’avoir un rêve. »
- Zouhir al-Shimale est un journaliste et photojournaliste originaire d’Alep (Syrie). Outre Middle East Eye, il a également collaboré avec Al Jazeera English, ZeitOnline, The New Arab et The National. Nick Hunt a contribué à la rédaction de cet article.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.
Photo : Oum Omar et Omar après leur libération (Zouhir al-Shimale/MEE).
Traduit de l’anglais (original) par VECTranslation.
Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].