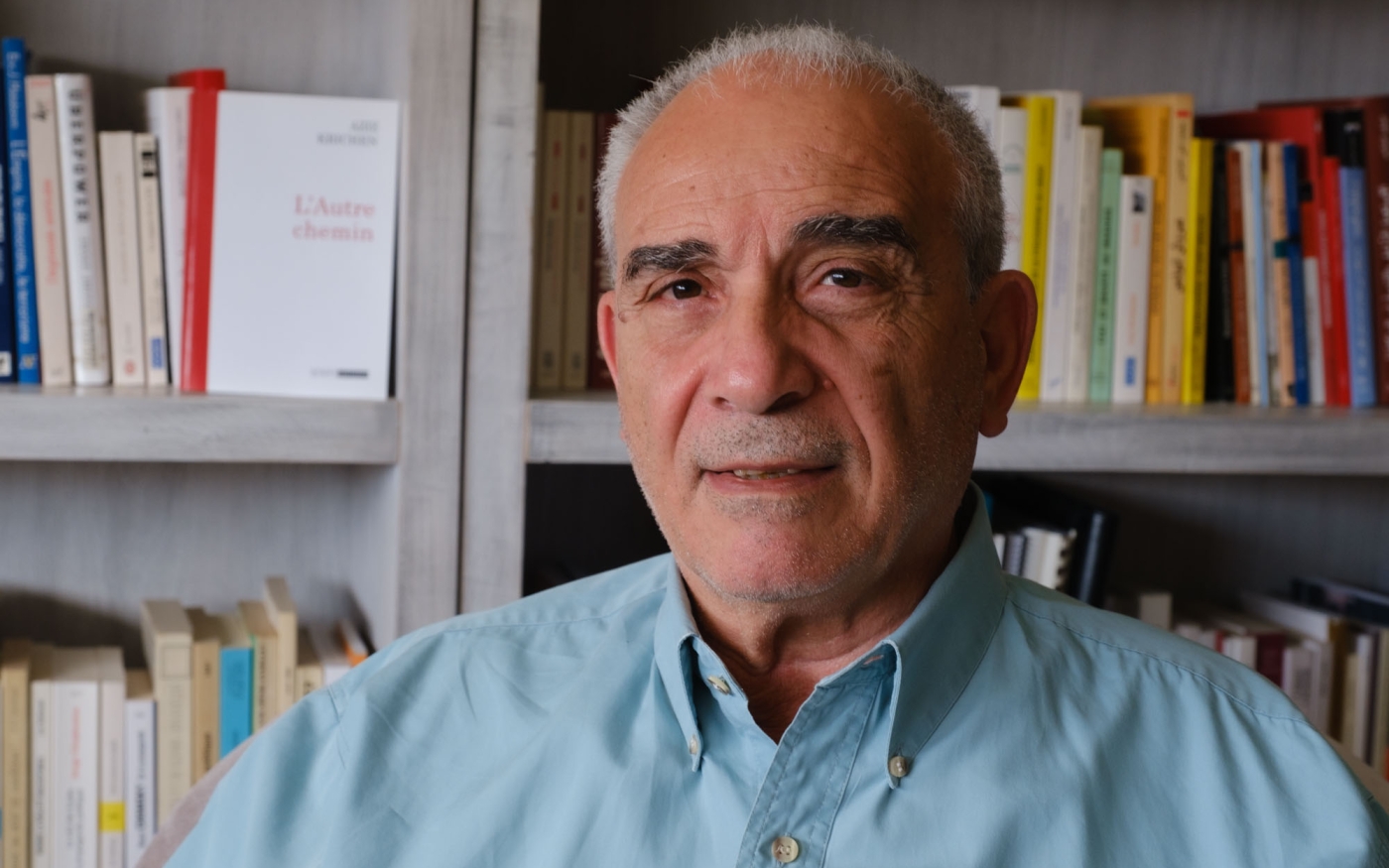Aziz Krichen : « La Tunisie est sortie de l’âge ‘’théologique’’ pour entrer dans l’âge politique »

Aziz Krichen a été, dans les années 1970, l’un des militants et théoriciens du mouvement d’extrême gauche autour de la revue Perspectives tunisiennes. Il a été le conseiller politique du président Moncef Marzouki de 2012 à 2014, avant de prendre ses distances avec lui. Il a publié depuis deux essais, La Promesse du printemps (2016) et L’Autre Chemin (2018).
Middle East Eye : En 1992, dans votre ouvrage Le Syndrome Bourguiba, vous aviez formulé une critique du modèle économique tunisien. Selon vous, derrière une libéralisation de façade, se cachait en réalité l’emprise du pouvoir politique sur l’économie dans une relation clientéliste. Est-ce que le modèle a changé depuis ?
Aziz Krichen : En partie seulement. Les relations entre le politique et l’économie ont changé, mais elles ne sont pas plus saines.
Pour avoir une idée de la réalité d’avant 2011, je peux donner un exemple tiré de la lecture de documents des archives présidentielles que j’ai pu consulter quand j’étais conseiller politique à la présidence.
L’office des terres domaniales avait envoyé un courrier à Ben Ali pour lui faire part du souhait d’un homme d’affaires d’acquérir des terrains supplémentaires afin d’accroître ses activités dans l’agrobusiness. Dans la marge, Ben Ali avait répondu : « Non. Pas lui, il est déjà suffisamment gros, aidez plutôt untel. »
Il y a des milliers d’exemples similaires. Cela montre que le pouvoir politique était le dispensateur des bienfaits, depuis les chefs d’entreprises jusqu’aux ouvriers et aux paysans. C’était le chef de l’État qui permettait d’entrer ou non dans le circuit de la richesse. Depuis l’époque du bey, « possesseur du Royaume de Tunis », le décorum a changé, on ne porte plus sabre et turban, mais le fonctionnement est resté le même.
L’origine de la richesse, ce n’est pas l’investissement dans la recherche et le développement, le recrutement d’ingénieurs de haut niveau pour élaborer des technologies innovantes, la conquête de nouveaux marchés à l’étranger, l’amélioration de la compétitivité. L’origine de la richesse, c’est la proximité avec le pouvoir politique qui permet d’accéder aux marchés et d’emprunter aux banques publiques sans jamais avoir à rembourser.
Il s’est constitué ainsi une petite oligarchie, quelques dizaines de familles qui contrôlent les hauteurs dominantes de l’économie, les affaires industrielles et commerciales, l’import-export, les business les plus lucratifs… en prêtant allégeance à Bourguiba, puis à Ben Ali. Cet accès privilégié au pouvoir politique constitue une rente.
Cette économie rentière a survécu à la mise en place d’institutions démocratiques après 2011. En revanche, quelque chose de fondamental a changé. Auparavant, le pouvoir politique contrôlait l’économie. À présent, c’est l’inverse.
Face à un pouvoir politique extrêmement affaibli, un État colonisé par les différents partis politiques, l’oligarchie rentière n’est plus la servante du pouvoir politique. Elle a vassalisé les acteurs politiques et l’État.
MEE : Par quel mécanisme cette emprise s’exerce-t-elle ?
AK : Durant les dernières décennies, l’oligarchie affairiste s’est transformée en oligarchie bancaire. Il s’est créé, notamment sous la présidence de Ben Ali, une vingtaine de banques privées. Or, ce sont les mêmes familles qui siègent aux conseils d’administration de ces banques et dans ceux des principaux groupes d’affaires.
Ce n’est donc pas un hasard si 70 % des crédits des banques privées sont accordés aux 150 à 200 entreprises, sur un demi-million, qui appartiennent à cette oligarchie. C’est un scandale absolu ! Au passage, certains des dirigeants de ces banques privées ont des ardoises colossales auprès des banques publiques qu’ils ont ainsi littéralement dépouillées !
Mais ce qui a donné autant de pouvoir à cette oligarchie aujourd’hui, c’est une réforme adoptée au nom de la lutte contre l’inflation : c’est la mise en place, en 2016, du sacro-saint principe monétariste de l’indépendance de la Banque centrale.
Cela signifie que la Banque centrale de Tunisie (BCT) ne peut plus faire tourner « la planche à billets », c’est-à-dire prêter à l’État. Quand l’État s’endette auprès de la Banque mondiale, de l’Union européenne, ou de n’importe quel bailleur international, la BCT prête cet argent aux banques privées, à un certain taux d’intérêt, qui le prêtent à leur tour à l’État à un taux supérieur.
L’oligarchie affairiste et bancaire contrôle tout. Cette force sociale est le principal obstacle au développement du pays, elle empêche la concurrence, elle s’enrichit sur le dos de l’État et elle a intérêt à maintenir la Tunisie dans une situation de dépendance
Résultat, l’essentiel des bénéfices de ces banques, dont les dirigeants tiennent des discours ultralibéraux, proviennent des intérêts payés par l’État. Et les banques tunisiennes, qui se protègent mutuellement des effets de la concurrence, ont les taux de profit parmi les plus élevés au monde !
Cet argent permet au monde des affaires de financer les partis politiques, d’entretenir l’agitation et d’interdire toute réforme. Et comme dans la classe politique tout le monde a des dossiers de corruption sur les uns et les autres, rien ne peut changer.
Pendant ce temps, les gens sont de plus en plus désespérés, mais ce n’est pas le problème de cette oligarchie. Ce n’est pas à elle de gérer les conflits sociaux, c’est le travail du gouvernement.
Ainsi, l’oligarchie affairiste et bancaire contrôle tout. Cette force sociale est le principal obstacle au développement du pays, elle empêche la concurrence, elle s’enrichit sur le dos de l’État et elle a intérêt à maintenir la Tunisie dans une situation de dépendance.
MEE : La dénonciation de l’économie de rente est devenue aujourd’hui un thème récurrent dans le débat public. Mais quelle politique permettrait de la démanteler ?
AK : Les rentiers bénéficient d’une économie protégée par un arsenal de réglementation et des réseaux de relations politiques. Il n’est pas normal que les marchés publics leur soient systématiquement réservés. Mais une véritable réforme ne peut se limiter à démanteler ces protections et à faire jouer les règles de la concurrence pour permettre à une minorité d’entrer à son tour dans le système.
C’est toute l’architecture qu’il faut reconsidérer, il ne s’agit pas seulement « d’assainir le climat des affaires ». La question de la rente est liée à la perte de souveraineté économique et à l’exclusion sociale du plus grand nombre.
La critique libérale de l’économie de rente a partie liée avec les investisseurs étrangers qui veulent entrer sur le marché national. C’est une constante depuis le XIXe siècle.
Les « modernistes », qui se glorifient que la Tunisie ait eu la première Constitution du monde arabe en 1861, oublient que son objectif essentiel était d’autoriser les investisseurs des puissances européennes à ouvrir des comptoirs commerciaux et à acheter la terre.
S’il faut faire sauter les verrous, c’est pour libérer les forces productives nationales, pas pour permettre aux Européens, aux Américains ou aux Chinois d’entrer dans un pays sans protection et d’accroître la soumission du marché tunisien aux flux extérieurs.
Transformer l’économie, c’est d’abord récupérer la souveraineté sur l’appareil financier et remettre en cause ce pseudo-dogme de l’indépendance de la Banque centrale. Il faut aussi apurer le système financier et séparer la détention du capital des banques de celle des entreprises. Les propriétaires des banques ne peuvent pas être juges et parties.
Pour s’attaquer à l’exclusion sociale et à la marginalisation territoriale, il faut reconsidérer le rôle de l’agriculture et de la paysannerie, son accès à la terre, à l’eau, aux crédits, au marché. Pour le moment, l’eau est détournée de l’agriculture vivrière vers les cultures de spéculation. Les terres domaniales restent souvent utilisées à des fins clientélistes et politiques. Les terres collectives sont mal exploitées…
Il faudrait aussi intégrer le secteur informel en levant les barrières à l’entrée.
Beaucoup des jeunes gens ou des politiques qui parlent aujourd’hui d’économie de rente n’ont pas forcément conscience de toutes ces implications.
La politique traverse depuis 2011 une phase de putréfaction biologique, elle est directement rattachée à la conservation de l’ancien régime rentier. Elle s’agite sans que cette agitation n’ait aucun rapport avec ce qui passe réellement dans le pays
MEE : Quelle est la traduction politique de cette critique de l’économie de rente ?
AK : L’économie de rente est devenue un thème à mode. Mais pour l’instant, on en reste aux discours. Je pense qu’avec l’approfondissement du débat, les positions vont se préciser et se différencier.
Mais d’ores et déjà, je vois dans l’émergence de ce débat un changement d’ampleur historique et un motif d’optimisme. C’est vrai que la politique traverse depuis 2011 une phase de putréfaction biologique, elle est directement rattachée à la conservation de l’ancien
régime rentier, même Ennahdha.
Elle s’agite sans que cette agitation n’ait aucun rapport avec ce qui passe réellement dans le pays. En même temps, l’émergence de ce débat sur la rente, ou l’élection de Kais Saied, sont les manifestations de l’attente d’un profond renouveau. Ce sont les signes de l’épuisement de la querelle identitaire, de la polarisation entre « modernistes » et islamistes. C’est un changement d’ère historique !
MEE : À quelle échelle de temps historique vous référez-vous ?
AK : Je me situe sur une échelle de près de deux siècles. En Tunisie, dans le monde arabo-musulman et même dans tous les pays concernés par l’expansionnisme européen, les élites se sont divisées autour de la question de savoir comment contenir les puissances impériales.
pUne riposte moderniste consistait à dire : ils sont plus forts parce qu’ils ont des institutions, une administration, un système économique plus performants que les nôtres, donc il faut les copier, il faut intégrer ce modèle chez nous de façon à pouvoir discuter sur un pied d’égalité.
L’autre réponse, traditionniste, consistait à dire que nous sommes dominés parce que nous nous sommes écartés de nos propres références culturelles, de nos propres institutions ; si nous retrouvons nos institutions originelles, nous retrouverons notre puissance perdue. En résumé, fallait-il imiter l’étranger ou nos ancêtres ? Mais dans les deux cas, c’était du mimétisme.
À partir de là, le débat public a été saturé par la querelle identitaire. Cette polarisation a totalement évacué les questions économiques et sociales, devenues inaudibles. Cela a paralysé nos sociétés en matière de développement économique, intellectuel et scientifique.Ce sont les tendances modernistes, parfois dans une variante socialiste, qui ont eu le pouvoir après les indépendances, en Tunisie, en Égypte, en Syrie, en Algérie… À partir des années 1970, pendant que l’extrême gauche était laminée par la répression, la mouvance tradionniste, dans sa version Frères musulmans, a émergé comme l’alternative.
Les soulèvements populaires de 2011, notamment en Tunisie et en Égypte, avaient essentiellement des raisons économiques et sociales. Il s’agissait de mouvements spontanés, c’est-à-dire sans élites ou organisations politiques. Ils exprimaient les vrais problèmes du pays, mais ils n’étaient pas capables de formuler une alternative.
Les forces politiques organisées ont naturellement occupé ce vide et, après la faillite des pouvoir « modernistes », les islamistes ont remporté les élections.
Ennahdha s’est avéré incapable de gérer le pays et la guerre identitaire a repris. Nidaa Tounes et Béji Caïd Essebsi ont recyclé une partie de l’ancien appareil de pouvoir, attiré les autres éléments de l’opposition et remporté les élections de 2014, avant de gouverner avec Ennahdha.
Même si ni les uns ni les autres n’ont dépassé le conflit identitaire, ni renoncé à évincer l’autre pour établir leur hégémonie, la polarisation s’est atténuée et les gens ont pu constater qu’en fait, ces deux forces défendaient les mêmes options économiques, gouvernaient de la même manière et que, même unis, ils étaient incapables de sortir le pays de sa crise.
C’est une expérience décisive parce qu’elle a rendu le conflit culturel à sa juste proportion : celle d’une querelle entre élites sans aucun impact sur les questions essentielles pour la majorité des Tunisiens.
Le résultat, c’est que le conflit identitaire ne peut plus être le principe structurant de la vie politique dans ce pays. La Tunisie est sortie de l’ère « théologique » et peut enfin entrer dans l’ère politique. C’est un progrès phénoménal, même si les couches superficielles de la politique s’agitent encore de manière stérile.
Les luttes intellectuelles et politiques vont pouvoir porter sur des changements réels. On ne se querelle plus pour savoir qui est le meilleur musulman. Dans la classe politique, tout le monde s’accuse mutuellement de corruption, c’est évidemment par calcul, pour nuire aux adversaires. Cela montre toutefois que, même de manière imparfaite, on est sortis des anciens paradigmes.
Dans cette nouvelle étape, les questions culturelles ne peuvent plus faire écran aux problèmes de fond soulevés par les populations, auxquels les politiques devront bien finir par répondre. Pour le moment, le peuple a été littéralement abandonné par ces élites traditionnelles, mais il commence à créer ses propres élites.
C’est un tournant pour la Tunisie et il peut avoir un impact sur les tous les autres pays arabes. C’est un processus au très long cours, mais il est amorcé, j’en suis persuadé.
Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].