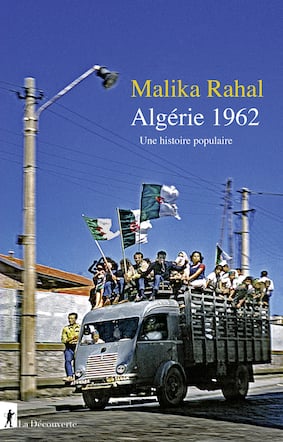Malika Rahal : « La puissance de 1962 donne l’impression que l’Algérie vit dans un présent permanent »

L’année 1962, au cours de laquelle l’Algérie a obtenu son indépendance de la France, dont on fête ce mardi 5 juillet le 60e anniversaire, est un événement à part entière, constitué de plusieurs séquences.
Dans son ouvrage Algérie 1962 : une histoire populaire (La Découverte), l’historienne Malika Rahal explore, selon une approche originale, cette année-là et la naissance de l’État algérien.
En s’appuyant sur de nombreuses sources, l’historienne invite le lecteur à « déplier 1962 ». Car le calendrier de cette année-là est marqué par les accords d’Évian le 19 mars, les festivités de la fête d’indépendance du 5 juillet, mais aussi d’autres événements comme le massacre d’Oran ou la crise politique de l’été, qui marquent une accélération du temps et un enchaînement d’épisodes.
Et derrière l’histoire politique, se cachent des expériences vécues, que restitue l’auteure au fil d’une enquête mobilisant témoignages, autobiographies, photographies, mais aussi films, chansons et poèmes.
Ce livre décrit des expériences collectives fondatrices pour le pays qui naît à l’indépendance : la démobilisation et la reconversion de l’Armée de libération nationale (ALN), la recherche des morts et disparus par leurs proches, l’occupation des logements et terres laissés par ceux qui ont fui le pays.
Middle East Eye : Le 5 juillet, l’Algérie célèbre le soixantenaire de son indépendance. Une journée historique mal connue, de fête, mais aussi un événement très politique jusque dans son déroulement et l’itinéraire emprunté dans les rues d’Alger. Que raconte la dramaturgie du 5 juillet 1962 ?
Malika Rahal : C’est impressionnant de voir, sur les films et photographies, des personnes faire foule, s’approprier l’espace public, avec à la fois une certaine mise en scène et de l’improvisation populaire.
La date du 5 juillet a été choisie pour faire référence à la capitulation du dey [gouverneur ottoman] d’Alger en 1830. Elle intervient après le référendum d’autodétermination, le 1er, et après le transfert de souveraineté entre autorités françaises et algériennes, le 3.
Le Gouvernement provisoire de la République algérienne [GPRA], présidé par Benyoucef Benkhedda, peut alors arriver à Alger en provenance de Tunisie, accueilli par une foule immense qui se presse tout le long du chemin séparant l’aéroport de la ville. Le 5 juillet, Benkhedda proclame l’indépendance.
Pour le 5 juillet, à Alger, le choix est fait d’un défilé regroupant les hommes de l’Armée de libération nationale [ALN] – notamment ceux de la zone autonome d’Alger – qui emprunterait les grands boulevards de la capitale puis continuerait jusqu’à Sidi-Fredj, lieu du débarquement des troupes françaises, le 14 juin 1830.
En chemin, au lieu d’aller tout droit, les habitants exigent des combattants qu’ils passent par Bab El Oued, le grand quartier européen d’Alger. Le cortège traverse donc le quartier en chantant « Bab el-Oued eddah el-oued » (Bab El Oued a été emporté par l’oued).
Mais le 5 juillet n’est qu’un des moments d’une série plus longue d’événements, qui relie le cessez-le-feu du 19 mars à la création de la République algérienne démocratique et populaire, le 25 septembre. C’est une année aux multiples significations : elle est à la fois la fin de la guerre, la fin de la colonisation et la naissance de l’État algérien moderne.
Toutefois, beaucoup de détails vécus durant cette année sont peu racontés, surtout dans l’espace public, comme s’ils avaient été rapidement éludés par la nécessité – au sortir de la guerre – de refermer une page douloureuse, de passer à autre chose, et de se remettre au travail.
Par ailleurs, pour beaucoup d’Algériens, les événements de l’année sont recouverts par les évocations d’un événement politique unique : la crise politique que connaît le Front de libération nationale [FLN], qui, durant l’été 1962, divise les Algériens et les conduit à des combats entre eux.
Cette crise est, jusqu’à aujourd’hui, utilisée à tort ou à raison pour expliquer toutes les frustrations politiques du présent. Mais elle tend aussi à gommer tous les autres moments pourtant essentiels de cette année.
MEE : Comment avez-vous abordé et hiérarchisé les données foisonnantes (archives, témoignages, discussions) sur cette période finalement méconnue ?
MR : Je suis partie de plusieurs questions, nées de la comparaison avec d’autres sorties de guerre (la Seconde Guerre mondiale en Europe, la guerre de Sécession aux États-Unis) ou d’autres fins de colonisation (les indépendances du Mozambique ou de l’Angola, ou l’Inde, avec la partition).
À partir de là, je pouvais m’interroger : y avait-il eu des réfugiés durant la guerre d’indépendance et un retour des réfugiés ? Comment avait-on recherché les corps des personnes tuées pendant la guerre ? Comment les combattants avaient-ils vécu leur démobilisation ?
À partir de bonnes questions, je pouvais utiliser des sources très disparates pour apporter autant d’éléments de réponses que possible en reconstituant des histoires.
Par exemple, j’ai utilisé les mémoires des moudjahidine [anciens combattants] pour saisir comment chacun avait vécu la fin de la guerre. Certains racontent l’émotion qui les saisit au moment de l’annonce du cessez-le-feu : pour les uns, c’est une joie intense, mais pour d’autres, c’est tout à coup le chagrin de pouvoir enfin pleurer tous leurs camarades morts.
Certains racontent l’émotion qui les saisit au moment de l’annonce du cessez-le-feu : pour les uns, c’est une joie intense, mais pour d’autres, c’est tout à coup le chagrin de pouvoir enfin pleurer tous leurs camarades morts
MEE : À la question de savoir ce que 1962 fait au temps, avez-vous trouvé une réponse ?
MR : J’étais frappée par le fait que, tout au long de l’année, les événements sont nombreux. Or, à chaque nouvelle, les habitants ne cessent de réimaginer leur avenir. Lorsqu’ils sont dans des camps de concentration (dits « de regroupement »), vont-ils rester dans le camp ou retourner dans leur village d’origine pour tenter de le reconstruire ? Ou bien migrer vers la grande ville ?
De la même façon, au fur et à mesure de l’année, les autorités algériennes, françaises ou les différents courants politiques ne cessent d’adapter leurs projections d’avenir aux nouvelles qui arrivent. C’est le cas par exemple lorsqu’on réalise que ce sont finalement la majorité des Français d’Algérie qui quittent le pays en une seule année.
Tout à coup, il faut imaginer comment compenser l’absence des cadres ou des enseignants français pour organiser l’administration ou le système éducatif.
Mais la projection vers l’avenir est aussi liée au sentiment que l’indépendance réalise un rêve espéré par beaucoup de longue date et à la force de l’utopie. Autrement dit, 1962 rejette la guerre et la colonisation dans le passé, opère une coupure du temps, et projette bien des habitants de l’Algérie dans le futur.
MEE : Diriez-vous que l’Algérie et les Algériens d’aujourd’hui sont toujours dans ce futur ?
MR : C’est en effet remarquable, la puissance de cette rupture du temps. Avant même que la guerre ne soit complètement terminée, et alors que l’armée française n’a pas encore quitté le pays.
Face aux urgences de l’époque, la nécessité d’organiser la rentrée scolaire, d’organiser la sécurité, de créer les institutions de l’État, de remettre en route l’économie et d’éviter le risque de la famine, le passé ne peut avoir une grande place.
Or, jusqu’à aujourd’hui par exemple, pour les historiens notamment, le pays après 1962 n’appartient pas vraiment à l’histoire. Tout se passe comme si nous étions dans un présent permanent, et cela tient à la nature et à la puissance de 1962.
MEE : Dans l’introduction de votre ouvrage, vous appelez à « déplier 1962 » et donc à inscrire cette année charnière dans une temporalité plus longue, à la fois du passé et du futur. Est-ce que 1962 est un précipité historique ?
MR : Oui, c’est un précipité historique car c’est un moment de très grande concentration des événements. Le risque de mon approche était de faire croire que tout se passe en 1962, que la nation se forge à ce moment-là, ce qui serait inexact car ce qui s’y passe a des racines lointaines.
Par exemple, les quartiers algériens s’algérianisent face à la violence de l’OAS [Organisation de l’armée secrète, qui a combattu clandestinement entre 1961 et 1963 pour le maintien de l’Algérie française], au sens où leurs habitants dépendent de moins en moins des autorités françaises et s’auto-organisent pour leur sécurité, les soins ou le ravitaillement. Mais ce phénomène ne naît pas en 1962, comme le montrent par exemple les efforts – même limités – du FLN pour célébrer des mariages afin de créer un état civil.
À l’inverse, de nombreux phénomènes de 1962 continuent à avoir des conséquences pour les décennies suivantes. C’est le cas de l’appropriation des terres ou des logements par les Algériens, dont on voit encore les conséquences sur la propriété privée jusqu’à aujourd’hui.
MEE : Votre livre décortique 1962 à travers le prisme de l’histoire populaire. Dans quelle mesure cette approche populaire porte-t-elle un enjeu historique mais aussi politique dans une époque où la confusion entre histoire, mémoire, ceux qui l’écrivent ou la racontent, est une réalité ?
MR : Cette histoire est celle des couches populaires, des plus modestes de la société, de ceux qui sont sans voix. Parmi ces segments, la classe ouvrière, paysanne, les femmes souvent aussi sont ceux qui laissent le moins de traces.
Dans le contexte colonial, l’histoire populaire est aussi celle de la population colonisée, qui laisse toujours moins de traces que la population coloniale. L’histoire populaire consiste en cet effort visant à redonner voix à la population colonisée pour étudier la façon dont elle a vécu les événements.
L’histoire populaire consiste en cet effort visant à redonner voix à la population colonisée pour étudier la façon dont elle a vécu les événements
Étrangement, au moment même où les Algériens accèdent à l’indépendance, ils continuent à ne pas apparaître ou à apparaître de façon marginale, dans leur propre histoire.
Le but était de raconter la façon dont un peuple accède à son indépendance, dont un peuple gagne sa liberté et la façon dont cela se traduit dans les corps, dans l’espace et dans le temps.
MEE : 1962, dites-vous, est un temps durant lequel se forgent des histoires…
MR : Je prends un exemple avec les personnes mortes pendant la guerre. Certaines familles avaient pu l’apprendre, d’autres non. 1962 est le moment où les camarades de maquis, les camarades de prison peuvent rendre visite aux familles souvent pour annoncer la mort et présenter leurs condoléances, en donnant des détails parfois destinés davantage à réconforter qu’à informer.
D’autres choisissent de ne pas dire la mort et de garder le silence, au risque de condamner les familles à un deuil impossible. À partir de ces informations, vraies ou fausses, les familles commencent à se construire des récits concernant leurs morts.
Par ailleurs, comme lors de toutes sorties de guerre, c’est souvent en 1962 que des acteurs parviennent à faire valoir ce qu’ils ont fait durant la guerre, en mettant en valeur des récits héroïques, ou au contraire, n’y parviennent pas.
Certains collaborateurs de l’armée française parviennent à faire oublier leurs actions passées, d’autres au contraire sont accusés à tort d’avoir collaboré.
En matière de récit, 1962 est aussi un temps des possibles. Et jusqu’à aujourd’hui, c’est source de débats infinis que de savoir si ce qu’on sait sur l’engagement dans la guerre d’untel ou d’untel est vrai ou faux.
MEE : Vous vous attardez sur la notion de « rumeur ». Vous décrivez 1962 comme un monde de « fausses nouvelles », « de rumeurs souvent terrifiantes, parfois pleines d’espoirs ». Dans quelle mesure cette « rumeur » empêche-t-elle d’aborder cette histoire avec recul et sérénité, des deux côtés d’ailleurs… ?
MR : Ce qui est spectaculaire en 1962, ce sont les grandes vagues de rumeurs. On est dans un temps intense où les événements sont très rapides. On entend beaucoup de choses et l’avenir qui se profile est rêvé pour les uns, attendu avec impatience pour ceux qui souhaitent l’indépendance. Il est terrifiant pour ceux qui n’en veulent pas. On a donc des rumeurs qui se répandent. Elles continuent, d’ailleurs, à nous intoxiquer jusque dans le présent.
C’est le cas des rumeurs du « sang volé » qui se propagent parmi les Français d’Algérie en 1962 et selon lesquelles les Algériens enlèveraient des Européens pour les vider de leur sang afin de soigner les blessés de l’OAS. Les rumeurs sont fausses, mais elles sont terrifiantes au point de précipiter la décision de partir de certaines familles françaises.
MEE : Parmi les rumeurs, l’exemple des « harkis », ces musulmans algériens restés fidèles à la France pendant la lutte pour l’indépendance, qui auraient été utilisés pour déminer les zones frontalières…
MR : Oui, ces harkis auraient été utilisés pour déminer les champs de mine. Il s’agit d’une affaire dramatique depuis 1962, avec 11 à 12 millions de mines antipersonnel posées et un déminage qui a duré jusqu’en 2017.
En 1962, on dit que des harkis ont été utilisés pour marcher sur ces champs de mine afin de les déminer. C’est quelque chose qui a été fait dans la France de 1945 par des prisonniers de guerre.
Or, la source utilisée toujours citée comme preuve est un rapport du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant un lieu précis. Ils affirment eux-même quelques jours plus tard avoir été intoxiqués par une fausse rumeur.
MEE : Votre livre propose un éclairage inédit sur le fameux « massacre d’Oran », le 5 juillet, événement majeur de 1962. À cette époque, Oran est une ville cadenassée par l’OAS, le consul américain William J. Porter la compare au ghetto de Varsovie pour les populations autochtones. Pourquoi est-ce important de raccrocher ce massacre, durant lequel des Européens mais aussi des Algériens ont été tués, à un continuum colonial et non à un épisode de la violence de la guerre de libération ?
MR : C’est pratiquement l’événement le plus connu de 1962. En France, quand on évoque cette année, c’est l’une des deux choses qui viennent immédiatement à l’esprit avec le départ des harkis et des pieds-noirs.
Le massacre du 5 juillet 1962 est en apparence incompréhensible et donc il permet de dire n’importe quoi sur le fait que le FLN aurait voulu un pays sans Européens, et aurait orchestré le massacre pour les faire fuir. C’est faux.
Le massacre du 5 juillet 1962 est en apparence incompréhensible et donc il permet de dire n’importe quoi sur le fait que le FLN aurait voulu un pays sans Européens, et aurait orchestré le massacre pour les faire fuir. C’est faux
En réalité, l’événement est mal défini pour deux raisons. D’abord, ce n’est pas un massacre d’Européens uniquement. C’est un massacre plus large dans lequel des Européens sont visés et tués en même temps que des Algériens. Il semble donc que l’on ait affaire plus largement à une violence vengeresse.
Ensuite, ce qui se passe à Oran ne commence pas le 5 juillet 1962. Cela commence au moins en février 1962, lorsque l’on se rend compte que la violence de l’OAS est intraitable et plus meurtrière à Oran qu’ailleurs dans le pays. Elle est symbolisée par l’attentat à la voiture piégée de Mdina Jdida le 28 février 1962.
De plus, contrairement à Alger, cette violence dure plus longtemps, presque jusqu’au référendum d’autodétermination du 1er juillet. Dans la ville, la tension est forte, les quartiers algériens sont assiégés, des snipers abattent ceux qui sortent des quartiers mais font aussi « des cartons » au cœur même des quartiers depuis les immeubles voisins en tirant dans l’enfilade des rues. Les habitants ne sortent plus, ne vont plus travailler, ne vont plus à l’école.
Il n’y a pas de temps de pause entre la tension extrême et la ferveur du 5 juillet. Durant les festivités, les rumeurs se répandent selon lesquelles l’OAS tire. Plus facilement à Oran qu’ailleurs, l’effervescence festive se transforme en effervescence violente.
MEE : Est-ce que cet été-là, marqué par les festivités de l’indépendance mais aussi par les violences, va préfigurer ce jeune État, l’Algérie post-62, et donc le présent ?
MR : L’expérience algérienne de 1962 est bien sûr également marquée, douloureusement, par les conflits entre Algériens et notamment entre les hommes du GPRA et le groupe dit « de Tlemcen », formé par Ahmed Ben Bella [chef du gouvernement de 1962 à 1963] et Houari Boumédiène, chef de l’armée.
Cette violence est de faible intensité au regard de la guerre contre la France, mais elle provoque un grand désarroi. Elle est souvent décrite comme l’arrivée d’une armée des frontières presque étrangère, qui se confronte aux combattants survivants et peu nombreux de l’intérieur pour prendre le pouvoir.
L’une des questions posées par ce conflit est un conflit classique de sortie de guerre : celui de la démobilisation et du désarmement des soldats. Pour l’Algérie, la question est celle de la reconversion de l’armée révolutionnaire, l’Armée de libération nationale, en une armée de métier nationale, l’Armée nationale populaire (ANP).
Ainsi, les négociations entre les arrivants de l’extérieur et les combattants de l’intérieur portent – on l’oublie – sur le devenir des combattants : pourront-ils adhérer à l’ANP ? Si oui, avec quel grade, quel solde ? Comment reconnaître les années de maquis ? Et s’ils ne veulent pas se réengager, comment pourront-il se réinsérer dans la vie civile ?
Par ailleurs, la question des conflits politiques et celle de la naissance de la politique dans l’Algérie des premières années de l’indépendance doivent être réétudiées en profondeur pour sortir d’une déploration trop facile.
Ce travail commence à être mené avec des historiens comme Amar Mohand-Amer ou Yassine Temlali, qui restituent les débats des premiers mois de l’indépendance.
Ils montrent ainsi que sur les questions de pluralité, de démobilisation, de langue, de place de l’armée, les postures sont bien plus nuancées et complexes qu’on ne l’imagine aujourd’hui.
MEE : L’Algérie serait restée coincée dans une espèce de « long 1962 » dont le hirak, vaste mouvement populaire ayant conduit à la démission d’Abdelaziz Bouteflika en 2019, serait un bégaiement. Qu’en pensez-vous ?
MR : L’idée d’être collectivement bloqués en 1962 – parfois exprimée pour critiquer le présent – n’est pas une idée d’historien. C’est au contraire la négation de toute l’histoire du pays, comme s’il n’y avait pas eu d’industrialisation, d’instruction massive, de développement culturel. Comme si le pays n’avait pas vécu le socialisme, la sortie du socialisme, la décennie noire [guerre entre l’armée au pouvoir et les islamistes armés] et n’avait pas été capable de s’en remettre.
L’idée d’être collectivement bloqués en 1962 – parfois exprimée pour critiquer le présent – n’est pas une idée d’historien. C’est au contraire la négation de toute l’histoire du pays
Bien sûr, les premières marches du hirak ont fait référence aux festivités de 1962, et certains ont chanté ensuite « Indépendance, Indépendance » ou « 1962 Indépendance de l’État, 2019 Indépendance du peuple ». D’autres n’ont pas apprécié ce slogan, qui minimisait la réalité de l’indépendance de 1962.
Mais les références historiques dans le hirak n’étaient pas seulement à la guerre et à la lutte pour l’indépendance.
Au contraire, les événements depuis le hirak du 22 février 2019 ont réveillé les souvenirs de toute l’épaisseur de l’histoire algérienne, et de décennies de discussions politiques. Même si c’est parfois difficile à accepter depuis la France, l’Algérie a une histoire qui ne se résume pas à la colonisation et au présent.
Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].