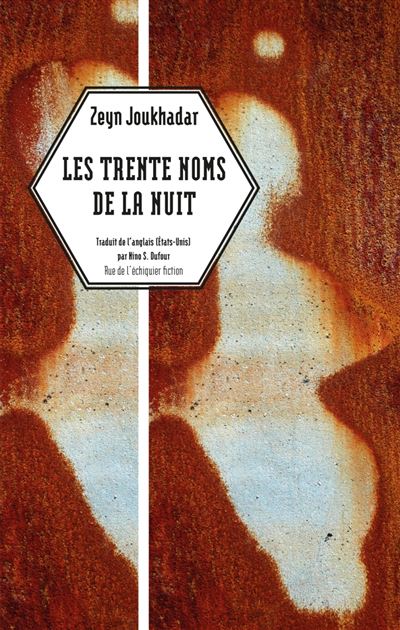Zeyn Joukhadar : « Même en tant que personne trans, on peut trouver le divin »

Dans Les Trente Noms de la nuit, paru aux éditions Rue de l’échiquier, Zeyn Joukhadar, auteur syro-américain transgenre, aborde les questions d’identité mais aussi de la transmission de la mémoire en tant que descendant d’immigrés et personne queer, à travers la quête de son héros.
Ce personnage non binaire, en pleine réflexion sur ce corps qui lui appartient et qu’il ne reconnaît pas, n’arrive pas à faire le deuil de sa mère, grande ornithologue. Passionné lui aussi d’oiseaux et ancien élève d’une école d’art, il n’arrive plus à peindre, tant la douleur de cette perte, cinq ans auparavant, le submerge.
Pour se pardonner, il entreprend de poursuivre les travaux de recherche de sa mère qui voulait prouver l’existence d’un oiseau rare, jamais référencé.
Pour cela, il va s’appuyer sur le journal intime d’une peintre syrienne, Laila Z, spécialiste de ces volatiles, et arrivée en Amérique dans les années 30. En découvrant l’histoire personnelle de la peintre, il trouvera bien plus que la trace de cet oiseau.
C’est le deuxième roman de Zeyn Joukhadar, après La Carte du souvenir et de l’espoir, mais le premier après sa transition. La question queer en Amérique, mais aussi au sein de la communauté syrienne et arabe, y est plus présente.
Avec beaucoup de poésie et de subtilité, il parvient à nous plonger dans la grande histoire par la petite.
Middle East Eye : Comment avez-vous appréhendé l’écriture de ce deuxième roman ?
Zeyn Joukhadar : Pour Les Trente Noms de la nuit, je me suis autorisé à raconter quelque chose de très proche de moi. J’ai toujours voulu écrire sur le fait d’être queer, mais je ne me sentais pas assez en sécurité pour le faire. L’écriture du manuscrit correspondait à mon propre processus de coming out, de transition. Cela a influencé l’histoire et mon personnage.
MEE : Comment avez-vous décidé d’écrire plutôt des personnages issus de minorités ?
ZJ : J’ai mis du temps à réaliser que j’avais le droit d’écrire sur des gens comme moi, d’en faire les héros d’histoires intéressantes. Un auteur doit écrire l’universel et on entend souvent que l’universel, ce n’est pas nous. On ne peut atteindre cet universel que par le personnel. Mon personnel, c’est celui d’une personne arabe, musulmane et trans. Il peut aussi être universel et largement lu.
MEE : Vous ne révélez le nom de votre personnage principal qu’à la fin du roman, quand il fait la paix avec cette identité. Quelle était votre intention littéraire ?
ZJ : On m’a souvent demandé pourquoi il n’avait pas de nom. On voulait connaître son dead name [nom de naissance d’une personne trans]. J’ai décidé de le raturer dans le manuscrit. Je voulais qu’un lecteur cis [cisgenre, dont l’identité de genre correspond au sexe de naissance] se dise : « L’auteur me signifie que je ne peux pas avoir cette information. Pourquoi je pense y avoir le droit ? »
Cet effacement pose la question de quelle histoire mérite d’être conservée nationalement
Je voulais le mettre dans cette situation d’incertitude sur son identité, comme le héros. Il ne sait pas comment il veut exister dans ce monde, comment les autres sont censés le percevoir. Dans nos sociétés occidentales, il y a cette injonction au coming out. Mais certains ne veulent pas, ne peuvent pas le faire. Je voulais que le lecteur y réfléchisse.
MEE : Il est question d’une quête identitaire pour le héros, mais aussi d’une quête de reconnaissance de la part des siens. C’est cela, appartenir pleinement à une communauté, selon vous ?
ZJ : Au fil de l’histoire, mon personnage principal réalise qu’il y a d’autres personnes queers autour de lui, qui sont perçues comme telles. Il fallait le montrer. On entend souvent que cela n’existe pas dans notre « communauté » [arabe]. Bien entendu, ce n’est pas vrai. Les histoires que l’on se raconte sur nous, collectivement, sont puissantes. En matière de représentation, c’est important.
MEE : Vous racontez aussi l’histoire de l’immigration syrienne aux États-Unis, l’existence de ce quartier de Manhattan, Little Syria, dont il ne reste plus grand-chose aujourd’hui, et la présence de ces personnes queers. Connaissiez-vous cette histoire ?
ZJ : Non pas du tout ! J’ai fait une résidence d’artistes au Musée national arabo-américain à Dearborn, et j’y ai fait des recherches. L’existence des personnes queers dans notre histoire y est assez explicite. J’y ai retrouvé une coupure de journal qui parlait d’un bar tenu par une femme queer américano-syrienne vers San Francisco, fermé par la police.
Je ne connaissais pas l’existence de Little Syria, alors que je suis né et que j’ai grandi à New York [en 1988]. Mon père est arrivé aux États-Unis dans les années 60, contrairement à cette immigration qui date des années 30. Ce quartier a été en grande partie démoli dans les années 40.
Tous les personnages, que ce soit dans le passé ou le présent, sont à la recherche du divin, chacun à sa manière
Pendant mes recherches, j’ai pu rencontrer une femme qui y avait vécu. Elle m’a raconté la solidarité entre les habitants, le sentiment réel d’appartenance à une communauté.
Dans une exposition sur cet ancien quartier à New York, j’ai vu des photographies, des cartes, des enregistrements musicaux, notamment la version arabe de l’hymne américain « America the Beautiful » ! Pourquoi n’en savions-nous rien ?
Cet effacement pose la question de quelle histoire mérite d’être conservée nationalement. La Washington Street Historical Society à New York se bat pour protéger les trois derniers bâtiments restants de ce quartier, et les désigner comme sites protégés. L’église Saint-Georges dont il est question dans le roman est aujourd’hui un club. La seule mosquée qui existait auparavant est devenue une pizzeria. Je ressens une sorte de nostalgie pour ces endroits qui n’existent plus.
MEE : L’autre personnage important du roman, ce sont les oiseaux. Est-ce une allégorie de l’immigration ?
ZJ : Il y a cette idée que les oiseaux traversent les frontières de manière incontrôlable, à leur guise. Mais il y a surtout une référence au recueil de poèmes La Conférence des oiseaux [du poète soufi persan du XIIe siècle Farid al-Din Attar], tout au long du livre.
Tous les personnages, que ce soit dans le passé ou le présent, sont à la recherche du divin, chacun à sa manière. Et l’une des quêtes du héros, c’est essayer d’imaginer, comme dans la Conférence des oiseaux quand les oiseaux découvrent qu’ils sont le reflet du divin, que même en tant que personne trans, même dans son corps, il peut trouver le divin.
MEE : Quasiment tous les personnages de votre roman vivent un deuil à leur propre manière. Comment avez-vous travaillé l’écriture pour ce thème particulier ?
ZJ : Le passé est présent avec nous. La peine que l’on ressent, c’est ce passé qui reste visible, alors qu’il est censé partir. Le fantôme de la mère en est une représentation. Dans ce roman, il s’agit avant tout d’en découvrir plus sur son histoire personnelle, familiale, afin de mieux imaginer son avenir.
Mais la découvrir n’est pas toujours synonyme d’apaisement. Une grande partie de cette histoire est émotionnellement lourde. Et c’est souvent pourquoi elle ne nous a pas été transmise. Il faut accepter cette réalité quand on la découvre.
Pour les personnes trans en particulier, on existe depuis toujours, mais cela ne signifie pas qu’on a tous survécu. On peut ressentir de la joie en découvrant que ces personnes sont arrivées bien avant nous. Mais nous devons aussi nous rappeler que beaucoup d’entre nous n’ont pas survécu. Quand on le sait, on est plongés dans un processus de deuil de ces frères et sœurs spirituels qui ont dépéri. Pour profiter de cette joie du passé, nous devons aussi prendre cette douleur.
MEE : Avec un personnage si proche de votre expérience d’homme trans, avez-vous eu des commentaires sur le fait que le livre puisse être autobiographique et non purement fictionnel ?
ZJ : Oui. Je suis trans, non binaire, arabe, et mon personnage l’est aussi, alors on pense que c’est moi. C’est souvent le cas pour les auteurs racisés. On voit nos œuvres uniquement comme des mémoires, des autobiographies. Je suis content de voir le soutien de plus en plus important de la part des maisons d’édition qui travaillent avec des auteurs trans, des auteurs trans racisés, sur de la fiction pure.
On a encore du travail à faire pour que ces mentalités changent complètement mais ça commence. Le public le demande. On est plus créatifs qu’on ne le pense, et on gagne en légitimité.
MEE : Dans le journal intime d’un des personnages, la peintre Laila Z, il est brièvement question de la Syrie qui combattait dans les années 1920-1930 les troupes coloniales françaises, composées de soldats algériens et marocains. Aviez-vous conscience de cette réalité coloniale avant d’écrire sur le sujet ?
ZJ : Non pas du tout. C’est l’une des choses que j’ai découvertes lors de mes recherches historiques. Cela m’a surpris et aussi mis en colère. Je n’avais pas envisagé d’écrire davantage sur le fait colonial en Syrie, avant cela. Mais j’y pense de plus en plus.
Être solidaires sur le plan politique est primordial aujourd’hui, mais la négrophobie en est l’obstacle majeur pour de nombreux Arabes-Américains
Il y a un lien entre la situation des Syriens arrivés en Amérique à l’époque et la relation entre les Arabes-Américains et les autres immigrés, la négrophobie présente chez les Arabes-Américains, surtout ceux qui ont la peau claire. C’est un vrai sujet.
De nombreux Arabes se considèrent comme blancs. Dans le livre, la famille de Laila est chrétienne, et ils sont décrits comme ayant la peau claire. Ils ont une expérience très différente d’autres Syriens musulmans ayant immigré plus tard, comme mon père, par exemple.
Il faut comprendre que même quand on a certains privilèges, ils sont conditionnés. Être solidaires sur le plan politique est primordial aujourd’hui, mais la négrophobie en est l’obstacle majeur pour de nombreux Arabes-Américains. C’est important de parler de ces différentes expériences.
Middle East Eye propose une couverture et une analyse indépendantes et incomparables du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et d’autres régions du monde. Pour en savoir plus sur la reprise de ce contenu et les frais qui s’appliquent, veuillez remplir ce formulaire [en anglais]. Pour en savoir plus sur MEE, cliquez ici [en anglais].